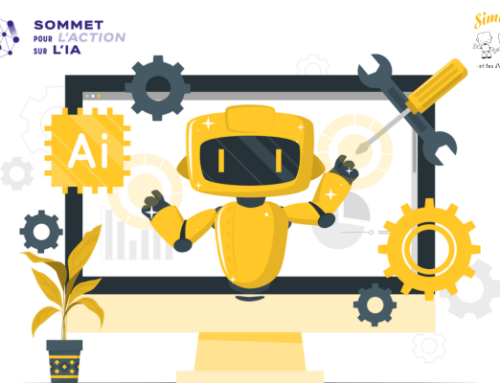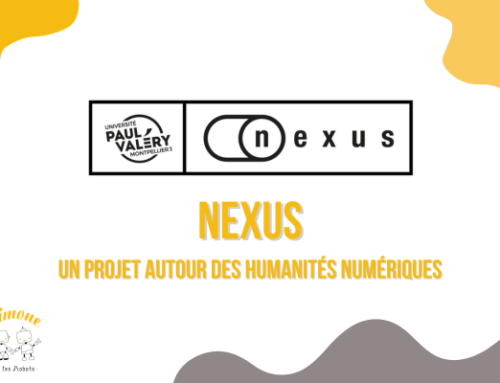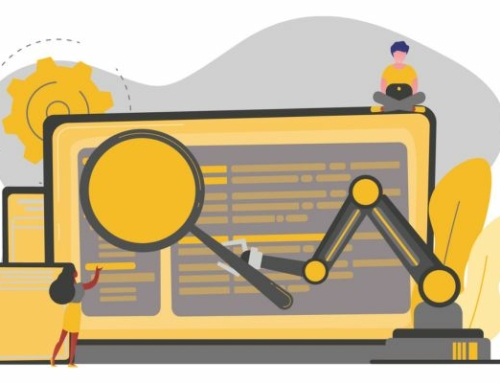Alors que les tensions internationales et les clivages nationaux sont de plus en plus intenses, le rôle majeur de l’éducation des populations demeure la clé de la lutte contre les fake news qui envahissent l’espace médiatique. Parce que nous croyons que les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche peuvent agir efficacement pour augmenter la résilience de notre jeunesse en proie aux assauts répétés venant de toutes parts, mais particulièrement des extrémistes ou de puissances extérieures à notre Nation, les Robots ont enquêté sur les dispositifs existants au niveau européen. Et si nous sommes parfois effrayés de la puissance des GAFAM, circonspects en découvrant les lois et les efforts de la Commission Européenne pour protéger liberté et indépendance de notre pensée, nous avons constaté que le sujet est très sérieusement étudié en France comme ailleurs.
Le constat général incite les organismes d’État à prendre les initiatives de manière centralisée, garantes sans doute, d’une certaine neutralité acceptée par les populations. Réglementer et surveiller les pratiques est une vision étatique très européenne et marque d’une volonté de transparence et de démocratie. Ailleurs, hors d’Europe, les dirigeants et leurs gouvernements n’ont pas toujours cette culture ou cette exigence. Ainsi, nous n’exprimons ici, ni critique ou ni assentiment d’une politique ou d’une autre, mais bien un examen objectif des moyens et des actions déployées pour combattre le fléau qui conduit certains à des comportements extrêmes ou violents.
Les fake news, un enjeu d’éducation national
En France, pour l’Éducation Nationale, c’est la mission du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), créé en 1983 pour structurer l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI). Ses missions incluent la formation des enseignants, la production et la diffusion de ressources en ÉMI, et l’organisation d’actions éducatives comme la semaine de la presse et des médias dans l’école. Cet structure s’appuie sur un Conseil d’Orientation et de Perfectionnement (COP) qui définit les orientations stratégiques, impliquant les pouvoirs publics, des autorités administratives, des syndicats, des fédérations de parents, des mouvements d’éducation populaire et des acteurs des médias. Le CLEMI produit et diffuse de nombreuses ressources pédagogiques pour les enseignants, indexées par niveau et thème, y compris des brochures pour les débutants et des dossiers pour les enseignants expérimentés. Des outils comme le jeu éducatif « Classe investigation » sont également proposés et ont fait l’objet de formations pour les enseignants.
Par ailleurs de nombreux partenariats avec les médias sont noués afin de responsabiliser mais aussi former à la fois les enseignants et les publics sur ces sujets sensibles. Chaque année, la « semaine de la presse et des médias dans l’école » permet aux enseignants de primaire, de collège et de lycée, d’aborder l’univers des médias et les enjeux de l’information avec leurs élèves. Autre action d’envergure nationale : à la rentrée 2022 un partenariat avec France Télévisions autour du dispositif « Tour de France de l’ÉMI et de la citoyenneté » a permis de former des enseignants de tous les territoires dans le cadre des plans académiques de formation.
« Les journalistes de la rédaction nationale, ceux des rédactions locales, les équipes du CLEMI et des formateurs académiques interviennent dans des ateliers pour des groupes de 15 à 20 enseignants sur des thématiques parfois complexes, comme la lutte contre la désinformation ou encore le pouvoir des images à l’ère des IA. »
Enfin, outre une loi visant à interdire les fake news durant les campagnes électorales (dont on peut interroger l’efficacité), la France a également mis en place une agence gouvernementale dédiée : Viginum, qui s’inspire du modèle suédois que nous évoquons un peu plus loin.
Quels sont les moyens mis en œuvre dans l’enseignement supérieur français ?
Dans l’hexagone, il existe également de très nombreuses initiatives au niveau des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, presque toutes les universités ont entrepris, a minima, un travail de sensibilisation de leurs personnels, des enseignants et étudiants. C’est depuis 2000, et suivant une initiative de l’Université Grenoble Alpes, que l’EMI (Éducation aux Media et à l’Information) est rentrée dans les référentiels de formation du supérieur. Ainsi, le Référentiel de compétences des mentions de licence, adopté en 2012, vise à donner une trame commune à ce niveau et intègre pour toutes les mentions des compétences transversales ainsi décrites :
- ««« Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère ».
Les Robots ont également relevé quelques actions significatives de ce mouvement d’ensemble lancé par des universités françaises, qui pour la majorité prennent le parti d’une dimension ludique dans l’apprentissage :
Ce dernier exemple est construit sur le modèle d’un autre jeu lancé en 2019, par Sorbonne Université. « Helllink », plongeait les joueurs dans le futur, en 2044, à Paris, et leur proposait de se retrouver dans la peau d’Elixène Seyrig, une experte en cybercriminalité qui doit enquêter sur un énorme piratage touchant Néo-Sorbonne, « à l’heure du conspirationnisme et de la perte de crédibilité aux grands médias ». Au travers de cette démarche d’éducation, Sorbonne Université « propose un questionnement critique sur le business de l’information afin de sensibiliser le public à des questions sociétales fondamentales qui le concernent directement ».
Si l’angle choisi par les universités françaises est celui d’une démarche active et ludique proposée aux étudiants, d’autres pays d’Europe ont imaginé des moyens différents.
Les bons exemples de nos amis anglo-saxons
Au Royaume-Uni, l’accent est mis sur l’apprentissage et le renforcement de « l’esprit critique ». Ainsi, l’Angleterre prévoit d’intégrer l’apprentissage des compétences de pensée critique dans le curriculum des écoles primaires et secondaires pour aider les enfants à identifier les contenus extrémistes et la désinformation en ligne. Les leçons proposées peuvent inclure l’analyse d’articles de journaux en cours d’anglais pour distinguer les faits avérés des fake news. Autre exemple, en cours d’informatique, les élèves peuvent apprendre à repérer les faux sites d’information par leur conception, et les cours de mathématiques pourraient inclure l’analyse de statistiques dans leur contexte. La BBC est particulièrement active sur ce sujet, en proposant de nombreux contenus de sensibilisation et d’apprentissages pour tous les niveaux d’étude. Enfin, au niveau national, il existe une loi, Online Safety Act, dont l’application n’est encore que partielle, semble-t-il.
Ce sont les pays de l’Europe du Nord, et particulièrement la Suède et la Finlande, qui paraissent les plus engagés dans cette démarche sécuritaire et salutaire pour nos démocraties. La Finlande est d’ailleurs classée en tête des pays européens dans une étude mesurant la résilience au phénomène des fake news, avec un indice d’éducation aux médias culminant à 76 (pour 100 de maximum) quand la France se situe dans la moyenne avec 56.
La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1000 kms avec la Russie, a développé depuis 2016, une entité nationale spécialisée sur le traitement des Fake New avec laquelle les écoles ou les universités travaillent pour mettre en place des formations. « Ce que nous voulons que nos élèves fassent… avant d’aimer ou de partager sur les réseaux sociaux, qu’ils réfléchissent à deux fois : qui a écrit cela ? Où a-t-il été publié ? Puis-je trouver la même information ailleurs ? » déclare, par exemple Kari Kivinen, directeur de l’École franco-finlandaise d’Helsinki et ancien secrétaire général des Écoles européennes. Faktabaari est un organisme qui adapte les méthodes de fact-checking professionnelles aux environnements scolaires, en développant des outils pour la « voter literacy » qui mettent l’accent sur la transparence du fact-checking et l’éducation aux médias. Les élèves ou les étudiants sont encouragés à devenir des « détectives numériques » et à appliquer des méthodes de vérification avant de partager des informations en ligne. Ils sont même amenés à essayer d’écrire eux-mêmes de fausses nouvelles dans un but pédagogique.
De son côté, la Suède a créé de longue date une agence gouvernementale dédiée à la défense psychologique. Placée sous la tutelle du ministère de la défense, la Swedish Psychological Defence Agency a pour objectif de renforcer la résilience de la population et la résilience démocratique du pays. L’agence dispose, d’une part, d’un département « Opérations », chargé d’identifier, d’analyser et de contrer les activités d’information et d’influence étrangères malveillantes et d’autres formes de désinformation, et d’autre part, d’un département « Développement des capacités », qui vise à renforcer la capacité sociétale globale en termes de défense psychologique, notamment par la formation des citoyens et le développement des connaissances liées à la défense psychologique.
Des sujets qui sont considérés comme d’une gravité extrême par nos voisins nordiques, tant il est clair que la sécurité des Nations peut être mise en cause par la désinformation et le déferlement des fake news en direction, notamment, des plus jeunes. Bien qu’il n’y ait pas de modèle unique, l’importance de l’éducation aux médias et à l’information, ainsi que le développement de l’esprit critique chez les jeunes, ressortent comme des éléments clés dans la lutte contre la désinformation dans ces différents pays.
En France, nous faisons toujours confiance à notre système éducatif pour traiter la question et rétablir une forme de vérité, mais aussi pour développer cet esprit critique indispensable à la connaissance. Nous nous appuyons également sur la science et la qualité de la recherche publique conduite par les enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités et les organismes de recherche. C’est sans doute en valorisant leur rôle essentiel et en maintenant un lien fort entre la population et la science que nous trouverons les moyens et les ressources nécessaires pour repousser la menace grandissante des fake news.
Sources :
https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/
https://www.bbc.co.uk/teach/articles/zfv7kty
https://www.cyu.fr/universite/media-et-communication/actualites/unite-enseignement-libre-fake-news
https://www.uca.fr/vie-etudiante/participe-au-concours-de-fake-news-de-luca
Envie de découvrir d’autres articles sur l’enseignement supérieur et la EdTech ? Rendez-vous sur le Blog des Robots !